L'auteur
Julio Ozán Lavoisier est né en 1940 dans la province de Mendoza, en Argentine. Il est philosophe, écrivain, documentaliste, navigateur et écologiste. Il a à son actif 9 traités philosophiques, traduits en anglais, en français et en espagnol.
Biographie
Il a étudié le droit à la Faculté de Droit de Cordoba et la philosophie à l’Université Nationale de Cuyo, en Argentine ; avant de continuer à Aix-en-Provence, en France, bien que, peu satisfait de ses études académiques, il a préféré poursuivre sa recherche de façon personnelle.
Pendant les années soixante, il prend part au mouvement contre-culturel de San Francisco, en Californie. Suite à quoi, il consacre 15 ans de sa vie à la réflexion, aux études et à la contemplation dans la Sierra Nevada, en Espagne où il commence à écrire.
En 1969, il lève l’ancre sur un vieux voilier depuis le Chili en compagnie de son frère Pepe Ozán pour une aventure qui l’emmène de l’autre côté de l’océan Pacifique. Par la suite et à bord de deux autres voiliers, il a navigué pendant 12 ans.
Il a voyagé en Inde pendant des années afin de réunir les expressions les plus diversifiées de la culture hindoue et ainsi donner vie à une vaste production audiovisuelle composée de 24 chapitres appelée « The Hindu Tradition ».
Dans son œuvre écrite, il cherche à établir un pont entre les doctrines orientales (hindouisme et bouddhisme) et occidentales (Idéalisme). Il a donné des conférences, en Argentine comme en Inde où il a été reconnu comme « le premier philosophe latino-américain publié en Inde » (Cervantes Institut, Delhi, Inde. Har-Anand Publishers, Delhi). Parmi ses conférences, il faut souligner celles données au « Centre Culturel Borges » dans la Galerías Pacífico, (Buenos Aires, Argentine), pour l’inauguration du Festival de l’Inde en 2009 ; celles données à différentes occasions à « l’India International Centre » (Delhi, Inde) et à l’Université de Nalanda lors du 4ème Colloque International sur le bouddhisme et l’hindouisme.
Ses années de navigation
Pendant 12 ans, il a parcouru plus de 50 000 milles nautiques (équivalant à deux tours du monde) à bord de vieux voiliers en bois qu’il a lui-même restauré et préparé pour la navigation en haute mer et qu’il a entretenu en effectuant toutes les réparations, la charpenterie, la couture des voiles, la mâture, etc.
“The Hindu Tradition”
Réalisé, scénarisé, filmé et commenté par Julio Ozán Lavoisier, ce travail comprend plus de 100 heures de tournage compilées en 12 heures réparties en 24 épisodes. Ce film serait un complément à l’œuvre écrite du philosophe.
Entrepris avec son frère, ce film implique une étude approfondie de la culture indienne, au cours de 14 années de voyages dans les endroits les plus reculés et les plus cachés du sous-continent, comme on peut le voir dans le film. Julio y a interviewé 20 personnalités indiennes éminentes, professeurs, intellectuels et connaisseurs de la culture indienne, qui expriment leur vision du monde, leur mode de vie, leur art et leur artisanat, leur religion, leurs croyances et leurs coutumes.
La Contemplation
Julio vit actuellement dans son ranch appelé La Contemplation, à quelques kilomètres de Luján de Cuyo, à Mendoza, où il a lancé il y a plus de 20 ans le projet d’une région écologique et d’un village durable au pied de la cordillère des Andes. Au fil des ans, Julio a reboisé la région avec plus de 1 000 arbres. Le projet de Réserve Naturelle et de reboisement progressif rejoint la ligne de conduite d’Ozán Lavoisier, qui consiste à mettre sa philosophie en pratique.
Son Idéalisme
Julio Ozán Lavoisier compare les trajectoires historiques et culturelles des civilisations orientale et occidentale et conclut qu’il est urgent d’intégrer les bases morales et spirituelles gréco-romaines ainsi que la tradition indienne en Occident, car il estime que notre culture a été envahie par un courant matérialiste qui l’a détournée des fondements nécessaires à un développement édifiant et complet.
« Du point de vue psycho-philosophique, nous pouvons dire qu’il existe une Conscience universelle dont l’homme fait partie et à laquelle il peut participer, de sorte que, tout comme son psychisme peut connaître la multiplicité, il peut connaître l’Unité, qui est Le noyau de cette Conscience » (Origine et Destin de l’Homme, 2008).
Réalisant une analyse exhaustive de la pensée occidentale dans la lignée du platonisme et du néoplatonisme, ainsi que de la pensée orientale fondée sur le bouddhisme mahayana et la pensée vedanta, Julio Ozán Lavoisier compare et intègre ces doctrines à partir d’une perspective unificatrice. « L’idée qui inspire cet Idéalisme universel est le fruit d’un haut niveau de conscience, qui leur a permis d’observer la réalité depuis les plus hauts sommets de l’esprit » (L’Esprit dans l’Histoire, 2011).
« Du point de vue cosmologique, la Conscience universelle est le commencement, le moyen et le but de l’existence, elle est la vie même de toutes choses, elle est le processus incessant au terme duquel le cycle de la vie s’achève et recommence » (La Recherche de la Conscience).
Cette convergence et cette synthèse se fondent sur la connaissance de l’esprit et sur une psychologie transcendantale particulière, selon une méthode unitive, adaptée aux questions de l’esprit et à la base d’une théorie de la connaissance (Psychosophie, Recherches Psycho-philosophiques sur la Nature Humaine) ; une philosophie de l’histoire (L’Esprit dans l’Histoire) ; une éthique, tendant à démontrer une origine commune dans une conscience morale qui unit tous les êtres vivants (Les Racines de la Morale) ; une esthétique qui nous fait voir la beauté du monde dans son unité primordiale (Les Racines de l’Art), une métaphysique qui inclut une vision religieuse (La Recherche de la Conscience Universelle), et une vision universelle dans laquelle les civilisations gréco-romaine et indienne convergent dans son propre philosophie (Civilisations Parallèles, Grèce-Inde ).
Ces œuvres articulées constituent un système philosophique qui englobe la pensée d’Ozán Lavoisier et les traditions susmentionnées. « En réalité, tout est contenu dans une Conscience Universelle : l’origine, le fondement et le destin de tous les êtres humains, de cette connaissance et intégration harmonieuse découle la liberté de l’esprit et, par conséquent, le bonheur inconditionnel » (La Recherche de la Conscience Universelle).
Ozán Lavoisier cherche à restaurer, dans son œuvre, l’Idéalisme en Occident et à promouvoir ce qu’il a appelé l’Idéalisme Universel.
Les Livres
LA RECHERCHE DE LA CONSCIENCE UNIVERSELLE
Ebook 2024
L’édition anglaise de ce livre publiée par Motilal Banarsidass Publishers à Delhi, en Inde, a suscité un intérêt général et une large diffusion en Europe ; à Londres AbeBooks (Advanced Book Exchange) et IberLibrocom en Espagne, elle est considérée comme un best-seller.
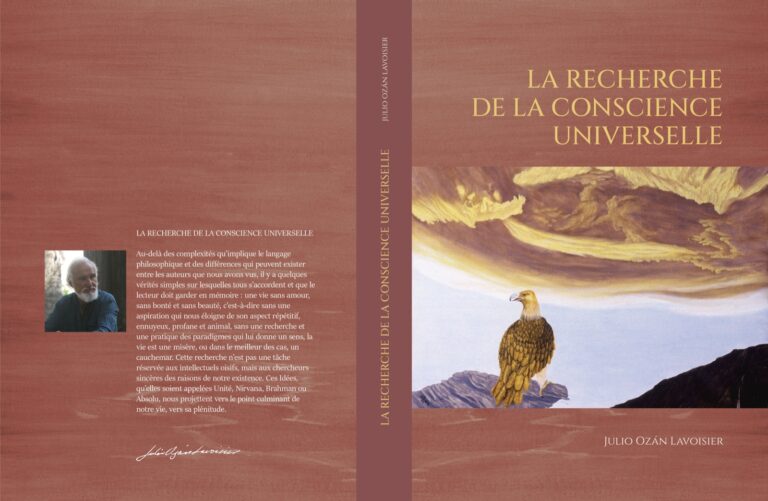
L’édition anglaise de ce livre publiée par Motilal Banarsidass Publishers à Delhi, en Inde, a suscité un intérêt général et une large diffusion en Europe ; à Londres AbeBooks (Advanced Book Exchange) et IberLibrocom en Espagne, elle est considérée comme un best-seller.
(Published by Motilal Banarsidass Publishers, New Delhi, India, 2024).
Au-delà des complexités qu’implique le langage philosophique et des différences qui peuvent exister entre les auteurs que nous avons vus, il y a quelques vérités simples sur lesquelles tous s’accordent et que le lecteur doit garder en mémoire : une vie sans amour, sans bonté et sans beauté, c’est-à-dire sans une aspiration qui nous éloigne de son aspect répétitif, ennuyeux, profane et animal, sans une recherche et une pratique des paradigmes qui lui donne un sens, la vie est une misère, ou dans le meilleur des cas, un cauchemar. Cette recherche n’est pas une tâche réservée aux intellectuels oisifs, mais aux chercheurs sincères des raisons de notre existence. Ces Idées, qu’elles soient appelées Unité, Nirvana, Brahman ou Absolu, nous projettent vers le point culminant de notre vie, vers sa plénitude.
SOMMAIRE
Prologue
Préface
Postulat méthodologique
Ce que j’entends par Philosophie de l’Histoire
L’histoire et nous
A propos de la recherche
De l’origine des idées
Platoniciens et aristotéliciens
Idéalisme universel
Types d’Idéalisme
Mystiques et philosophes
Monothéisme et polythéisme
Monisme et dualisme
Le Dieu des philosophes, des mystiques et du folklore
Le Dieu des philosophes et des artistes
LA RECHERCHE À GRÈCE
Introduction
Les présocratiques
Xénophane
Héraclite
Parménide
Anaxagore
La physique des présocratiques
Platon
Aristote
LA RECHERCHE À ROME
Rome et Alexandre
Stoïcisme à Rome
Rome et Virgile
Plotin
Les mythes et la réalité
Plotin et Platon
Plotin à la lumière de mon expérience
Plotin, sa projection universelle
L’ESPRIT AU MOYEN ÂGE
Introduction
Stoïcisme et Christianisme
Le christianisme dont nous avons hérité
Le Moyen-Âge dans les trois grandes civilisations
Platonisme et civilisation
LA RECHERCHE DANS LA RENAISSANCE
Byzance
Byzance et Florence
George Gémiste Pléthon
Ficin
L’esprit de la Renaissance
Renaissance et Moyen Âge
L’Esprit universel dans la Renaissance
L’aristocratie et l’Église
Humanisme, Renaissance et Réforme
Réforme et Contre-réforme
Giordano Bruno
Bruno et l’imagination
Bruno, conclusion
Spinoza
De la connaissance de l’Âme
Spinoza, conclusion
LA RECHERCHE DANS LE SIÈCLE DES LUMIÈRES
Introduction
Kant
La vision historique de Kant
LA RECHERCHE DANS LE ROMANTISME
Introduction
Fichte
La religion de Fichte
Schelling
Philosophie de la Nature
L’intuition de Schelling
La religion de Schelling
Hegel
La dialectique dans l’histoire chez Hegel
Idéalisme et Philosophie de l’Histoire
Idéalisme, conclusion
Le Romantisme des artistes
Schopenhauer
Le Monde comme Volonté
Le Monde comme Croyance
Les circonstances internes de Schopenhauer
Le Monde comme Représentation
Vie ascendante et décroissante
La tragédie de Schopenhauer… et des philosophes
La vision cosmique en Amérique
SYNTHÈSE DES DÉPLACEMENTS DE L’ESPRIT
Grèce
Rome
Moyen Âge
Renaissance
Romantisme
Nos temps à la lumière du passé
Expérience religieuse et connaissance
Perspective orientale et occidentale
Du bouddhisme et de l’hindouisme
MON IDÉALISME
Philosophie vitale = idéalisme intégrale
Mes pensées en tant que système
La connaissance émane de l’Unité
Mon idéalisme et les perspectives
Disparité dans la philosophie
Raison, foi et expérience
Conscience unitive et connaissance
Intuitions et vécus
L’expérience de l’esprit
CONSCIENCE UNIVERSELLE
Le premier principe 1
Conscience universelle 2
Conscience universelle 3
Conscience universelle 4
Dieu et Conscience universelle
Le chemin religieux
Les Manifestations primaires
De la connaissance des Manifestations primaires
Panthéisme moniste
Un point de convergence
La Conscience universelle et le cosmos
Synthèse de ma proposition
CIVILISATIONS PARALLÈLES GRÈCE-INDE
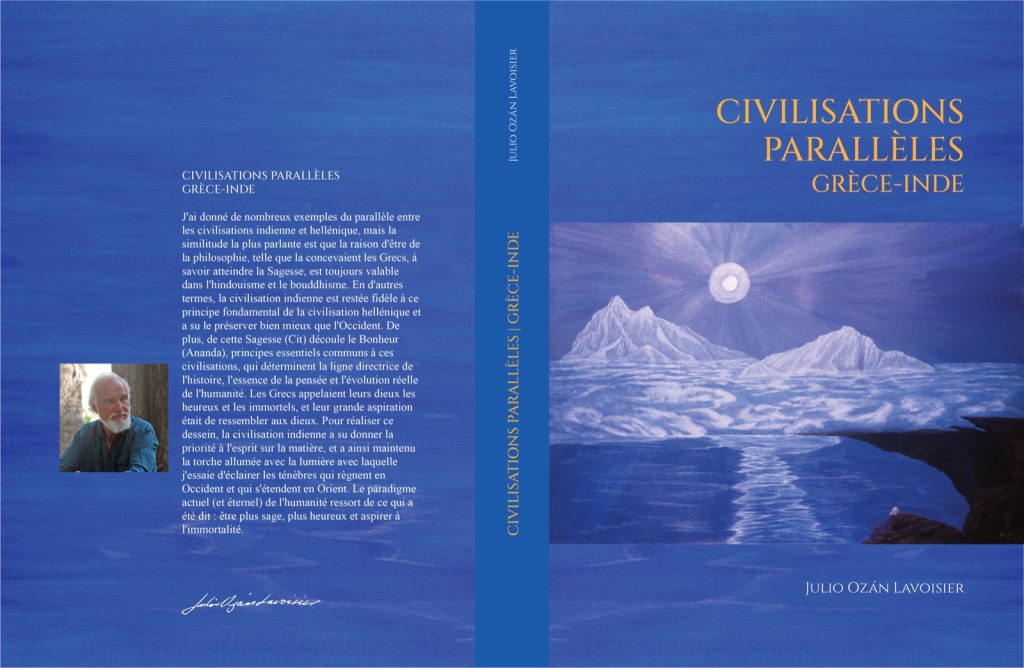
Ebook 2024
PARTIE 1 : L’ORIGINE
SOMMAIRE
Prologue
Le dessein de ce livre
Synthèse à partir des premiers principes
De l’entendement
Le sens des mythes
Le mythe chez Platon
Pourquoi Mircea Eliade
À propos d’Eliade
L’Origine du temps
Le temps et la divinité
Au-delà d’Eliade
Les mythes et la Conscience universelle
Ma vision de la question
Plan vital et évolution
Les mythes de nos jours
A propos des initiations
Mythologie et philosophie
Mentalité mythique et unitive
La Philosophie de la Mythologie de Schelling
Précision épistémologique
Conclusion
PARTIE 2 : LA GRECE ET L’INDE
SOMMAIRE
LA GRECE
Le mythe d’Ariel
Esprit et religion grecs
Les dieux grecs
L’art grec
Vertus du polythéisme
Religion et Nature
Vision circulaire et linéaire
La vision cyclique du temps
LES VERTUS GRECQUES
L’équilibre
Héroïsme et modération
A propos de la vie et de la mort
L’organisme social
L’organisme universel
Périclès
Le miracle grec
Hadrien
Conclusion
A PROPOS DES GRECS ET DES HINDOUS
Des mythes grecs et hindous
La Genèse en Inde
Parallèles dans la littérature épique et dans les mythes
Dieux obscurs et lumineux
Dionysos et Apollon
Le sens héroïque de la vie en Grèce
Le sens héroïque de la vie en Inde
La tragédie grecque
Pèlerinages et célébrations en Grèce
Pèlerinages et célébrations en Inde
Similitudes dans l’architecture religieuse
Autres ressemblances
CONCLUSIONS PHILOSOPHIQUES
Plotin et les doctrines indiennes
Du Bonheur et de la Vie
De la Beauté
La recherche de l’Unité
PARTIE 3 : LA CIVILISATION INDIENNE
SOMMAIRE
IDEES PRELIMINAIRES
La pensée indienne et ma philosophie
Du monothéisme et du polythéisme
Du monisme et du dualisme
Les bases philosophiques
De la psychologie
De l’évolution de la conscience
De la philosophie de l’histoire
Des idées, de la connaissance et de la vie
Une ébauche de l’Universus
Synthèse de ma proposition
BOUDDHISME ET HINDOUISME
Unité du Dhamma et du Dharma
De la compréhension du Dhamma et du Dharma
Du bouddhisme et de l’hindouisme
Le bouddhisme dans l’histoire de la civilisation indienne
La culture bouddhiste dans la civilisation indienne
Les perspectives en Orient et en Occident
L’évolution de l’esprit dans l’hindouisme
L’évolution de l’esprit dans le bouddhisme
PARTIE 4 : L’HINDOUISME
SOMMAIRE
Les Vedas
L’héritage des Vedas
La décadence des Vedas
Epoque cruciale
Après les Vedas
Le Samkhya dans l’hindouisme
Les Gunas dans les faits
Les Gunas dans l’histoire
Le yoga, introduction
De la connaissance dans Patanjali
Le Dieu de Patanjali
Patanjali et ma vision
Introduction aux Upanishads
L’Aitareya Upanishad
La Prasna Upanishad
La Mandukya Upanishad
La Kena Upanishad
L’Isha Upanishad
La Mundaka Upanishad
La Bhagavat-Gita, introduction
La Bhagavad Gita
Le Karma Yoga dans la Gita
La sagesse de la Gita
Du danger des sentiments
Intuitionnistes, intellectuels, dévotionnels et animaux
Les Brahma Sutras
Shankara
Shankara et la Taittiriya Upanishad
Le Vivekacudamani
Ramanuja
Ramanuja et les Brahma-Sutras
Aurobindo et l’Isha Upanishad
COMMENTAIRE GENERAL
De l’Esprit et de la matière
De l’Observateur
De l’Atman
De la révélation
Des techniques spirituelles
De l’Esprit et des Yogas
Des pouvoirs
De la réincarnation et du karma
Du plan interne
De la Maya
Des limites de la connaissance transcendantale
Idéalisme vital
Conclusion
PSYCHOSOPHIE: INVESTIGATIONS PSYCHO-PHILOSOPHIQUES SUR LA NATURE DE L’ETRE HUMAIN
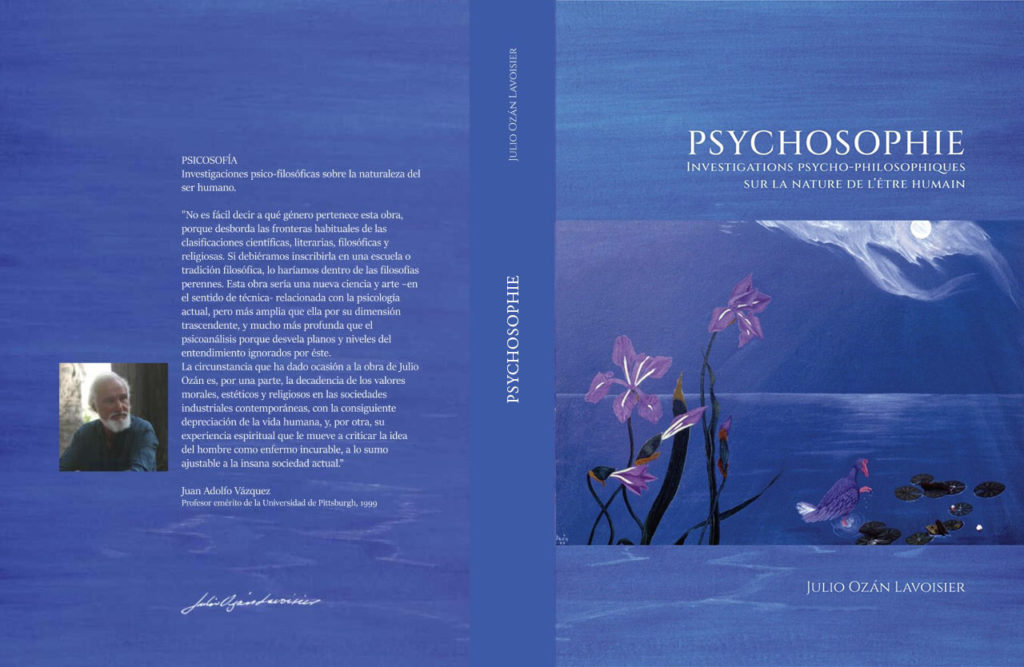
Ebook 2022 – Imprimié en papier 2010 par Editorial Zeta.
Original en espagnol, Editorial Dunquen 2004.
Investigations psycho-philosophiques sur la nature de l’être humain.
(Dunken, Bs.As. 2004)
The coverage of this book is an oil painting on canvas of the author.
PROLOGUE
Lecteur, voici un libre, travail original, riche en idées et en préceptes qu’il convient de prendre au sérieux pour le bien de chacun et de l’humanité en général. Il n’est pas aisé de dire le genre auquel il appartient, car il déborde les frontières habituelles des classifications scientifiques, littéraires, philosophiques et religieuses. S’il fallait l’inscrire dans une école ou une tradition philosophique, nous serions tentés de l’inclure dans les philosophies pérennes dont il possède la source d’inspiration et l’essentiel. Le livre a, par ailleurs, tous les éléments propres à une véritable philosophie. Ozan Lavoisier est un philosophe mystique. Son oeuvre, qu’il lui donne le nom de psychosophie, serait une science nouvelle et un art (au sens de technique), relié à la psychologie moderne, mais plus ample qu’elle par sa dimension transcendante, et beaucoup plus profonde que la psychanalyse parce qu’elle dévoile des plans et niveaux d’entendement ignorés par cette dernière.
Dans ces quelques pages, je m’efforcerai de passer en revue les thèmes de cet essai et de souligner les difficultés qui pourraient prendre le lecteur au dépourvu.
Le point de départ de cet essai est, d’une part, la perte des valeurs morales, esthétiques et religieuses dans les sociétés industrielles contemporaines, cause de la dépréciation de la vie et, d’autre part, l’expérience spirituelle propre à l’auteur, qui le pousse à critiquer l’idée d’un homme définitivement malade ou, tout au plus, adaptable à une société malsaine. Si le lecteur n’a pas perçu le désordre de la vie contemporaine, s’il croit que des palliatifs économiques ou psychologiques sont susceptibles d’en venir à but, sans doute la psychosophie ne lui sera d’aucun secours. La cassure n’est pas seulement entre un conscient et un inconscient. Les problèmes les plus graves de la civilisation contemporaine sont en rapport avec la perte de contact avec la Nature et avec l’Esprit universel.
La prise de conscience des désirs et des craintes injustifiées qui occupent et préoccupent l’être humain, est capitale, d’après l’auteur, car ce n’est qu’au-delà que débutera la voie vers la transcendance. Il est donc nécessaire que le lecteur ne se borne pas à lire, mais qu’il mette en pratique les exercices spirituels nécessaires. Tout dépend de sa bonne volonté. C’est pourquoi l’auteur dit que si nous voulons vraiment connaître la Divinité, c’est à dire la Paix, il faut commencer par faire l’expérience intime. La psychosophie, en tant que fondement de l’expérience personnelle, n’est pas dogmatique ; comme dans le Bouddhisme la seule autorité repose sur l’expérience personnelle.
La technique spirituelle que conseille la psychosophie s’apparente quelque peu au Bouddhisme, comme l’indique l’auteur lorsqu’il énonce que l’aspirant est pleinement établi dans la conscience unitive lorsque les manifestations primitives lui deviennent évidentes, qu’il est prêt au dernier saut, lequel devra se faire dans le Vide, sans l’aide d’un Dieu personnel. Cette connaissance est irréductible à la méthode scientifique, car on ne peut lui appliquer les catégories spatio-temporelles. Aussi l’auteur ne veut pas que l’on croit à sa vision de la Réalité, mais qu’on la vérifie. « Je ne parle pas pour ceux qui veulent continuer á vivre une réalité abstraite, mais pour ceux qui veulent mieux comprendre la Réalité dans laquelle l’être humain vit.» Il serait vain d’affirmer quoi que ce soit de la Pure Conscience, car rien ne peut décrire l’Absolu. C’est en fait d’évidence, et pour adapter l’esprit à ce niveau, il faut, outre une vie retirée, la direction d’un maître, de préférence bouddhiste zen.
Il n’est pas de l’intérêt de la psychosophie de raconter les merveilles issues de la véritable connaissance, mais d’amener à en faire l’expérience. L’une des vois est le control des rêves; cela exige une étroite vigilance, ainsi qu’une vie retirée loin des stimuli étrangers engendrés par les mégalopoles qui « distraient » et ôtent toute « vigilance » : « La jungle moderne ne se prête guère à ce type d’exercices spirituels. »
Pour pouvoir se submerger dans notre monde intérieur, il nous faut cesser de nager à la surface de nos représentations externes. L’esprit peut descendre naturellement, sans effort, au plan de perception directe. Evidemment, nous dit l’auteur, « cette opération n’est pas si simple ».
Des belles pages son consacrées à Platon. A propos de Mircea Eliade, cité et approuvé à des nombreuses reprises, l’auteur écrit : « Il est un de ceux, peut nombreux à notre époque, qui se soit appliqué à étudier les religions avec le désir sincère d’y découvrir des vérités et non des nouveautés, et avec le respect qu’elles méritent. » A propos d’Eliade, que j’ai personnellement connu, je dirais que certains connaisseurs de religions et de mythologies, n’ayant pas atteint l’expérience mystique ont, néanmoins, fortement éclairé des modes de vie religieux pour le plus grand bénéfice de leurs lecteurs. Le lecteur est, peut être, l’un d’entre eux. Ce qui n’est pas le cas de ceux qui, dépourvus de respect face aux traditions mystiques et, par-là même, ignorant la réalité spirituelle de l’être humain, ont osé émettre des opinions sur la réalité religieuse. Aussi l’auteur écrit-il : « La seule preuve indubitable de l’existence de l’Essence (ou si l’on préfère, d’un Dieu présent et Un), est intransmissible. L’Essence est, non seulement impersonnelle, est plus que personnelle, elle ne peut même pas se dévoiler au discernement de qui fait l’expérience. Dieu ne peut être prouvé et vérifié qu’à partir de sa propre perspective.»
Pour permettre au lecteur de comprendre les différents plans de l’esprit, l’auteur a esquissé divers schémas, en précisant qu’il ne s’agit pas de plans géométriques mais d’états d’âme. Nous rencontrons ici la difficulté dont parlait Bergson, opposant la fluidité des états de l’âme à la rigidité des représentations spatiales. Ozan Lavoisier dessine d’abord le passage de la conscience individuelle à la conscience unifiée, en passant par la conscience altruiste ou conscience unitive latente. D’autres schémas illustrent le cheminement de l’esprit vers son unification à partir d’autres points de vue. Puisque ces facultés doivent atteindre la conscience unitive, siège de la conscience esthétique, morale et religieuse, chacune d’entre elles permet une voie de connaissance différente. Ces schémas n’ont qu’une valeur relative. L’auteur écrit : « L’homme moderne, assis sur sa perspective égocentrique, absorbé par le monde extérieur, peut à peine écouter sa conscience.»
Dans la Seconde Partie l’auteur met en rapport psychosophie et psychologie. Il commente alors trois psychologues illustres qui se sont aventurés dans le domaine religieux. L’expérience spirituelle exposée dans la Première Partie de l’essai, permet une critique, à mon sens, fort nouvelle ; la Seconde Partie pose ainsi un jalon dans l’histoire critique de la psychanalyse et deviendra sans doute un texte classique.
L’auteur insiste sur la nécessaire purification morale, préalable à toute vraie connaissance. Pour voir disparaître la dualité sujet-objet, il faut éliminer le premier terme, ce qui implique que l’on ait suivi une voie rigoureuse de purification et que l’on ait atteint une réalité transcendante, laquelle fait déjà partie du domaine sacré. C’est dire que pour arriver à Dieu il faut avoir vécu une expérience religieuse que l’on ne peut induire, comme on ne peut induire aucune expérience personnelle.
En faisant de l’expérience religieuse un synonyme de religion, Julio paraît oublier, par moments, que le phénomène religieux peut aussi être entendu comme un phénomène qui affecte le plan social, même en admettant l’irréductibilité du religieux à d’autres plans. Mais l’oubli est seulement circonstanciel, à peine l’occasion lui est donnée, il rétablit le lien entre les deux réalités.
Toutefois, ce possible oubli ne diminue en rien le message essentiel de la psychosophie, qui, les bras ouverts, comme ce prologue, s’offre au lecteur, telle une nouvelle manière de voir le monde.
Juan Adolfo Vazquez, Pittsburg, 1999.
J. A. Vazquez est professeur émérite de l’Université de Pittsburgh, P.A., USA.
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE
- Chapitre I : Circonstances générales
- Chapitre II : Antécédents occidentaux
- Chapitre III : Antécédents orientaux
- Chapitre IV : Le conscient, ce mal nommé
- Chapitre V : Un esprit mutable pur une réalité mutable
- Chapitre VI : Un schéma de la psyché
- Chapitre VII : Conscient et inconscient : un cercle vicieux
- Chapitre VIII : La voie des intuitions
- Chapitre IX : La voie des sentiments
- Chapitre X : La voie du vécu
- Chapitre XI : La voie esthétique
- Chapitre XII : La voie éthique
- Chapitre XIII : La voie religieuse
- Chapitre XIV : De quelques supports nécessaires
- Chapitre XV : La perspective essentielle
- Chapitre XVI : Le cycle de la vie
- Chapitre XVII : Conscience unitive et unifiée
- Chapitre XVIII : Mémoires cumulative et unitive
- Chapitre XIX : Du control des rêves
- Chapitre XX : Antécédents d’une voie unitive de connaissance
- Chapitre XXI : La raison de la déraison du mythe
- Chapitre XXII : Mythe, réminiscence et mystique
- Chapitre XXIII : Le problème actuel
SECONDE PARTIE. PSYCHOSOPHIE ET PSYCHOLOGIE
- Chapitre I : Psychosophie et psychologie
- Chapitre II : Sciences et transcendance
- Chapitre III : Sciences et transcendance (suite)
- Chapitre IV : Les religions et le plan interne
- Chapitre V : La première invasion : Freud
- Chapitre VI : Freud et Moïse
- Chapitre VII : Initiations et connaissance
- Chapitre VIII : Prémisses de méthode
- Chapitre IX : Seconde invasion : Jung, un être ambigu
- Chapitre X : La formule alchimique : Bien = Mal
- Chapitre XI : Les archétypes, un déterminisme psychologique
- Chapitre XII : Jung et Job
- Chapitre XIII : La « Religion » de Jung
- Chapitre XIV : Le Soi
- Chapitre XV : Jung et le Christianisme
- Chapitre XVI : Jung et l’Orient
- Chapitre XVII : Mémoire unitive et inconscient collectif
- Chapitre XVIII : Jung, philosophe
- Chapitre IXX : Psychanalyse et Bouddhisme Zen
- Chapitre XX : Connaissance et action de l’homme unitif
- Epilogue : Maximes et Paradoxes
ORIGINE ET DESTIN DE L’HOMME
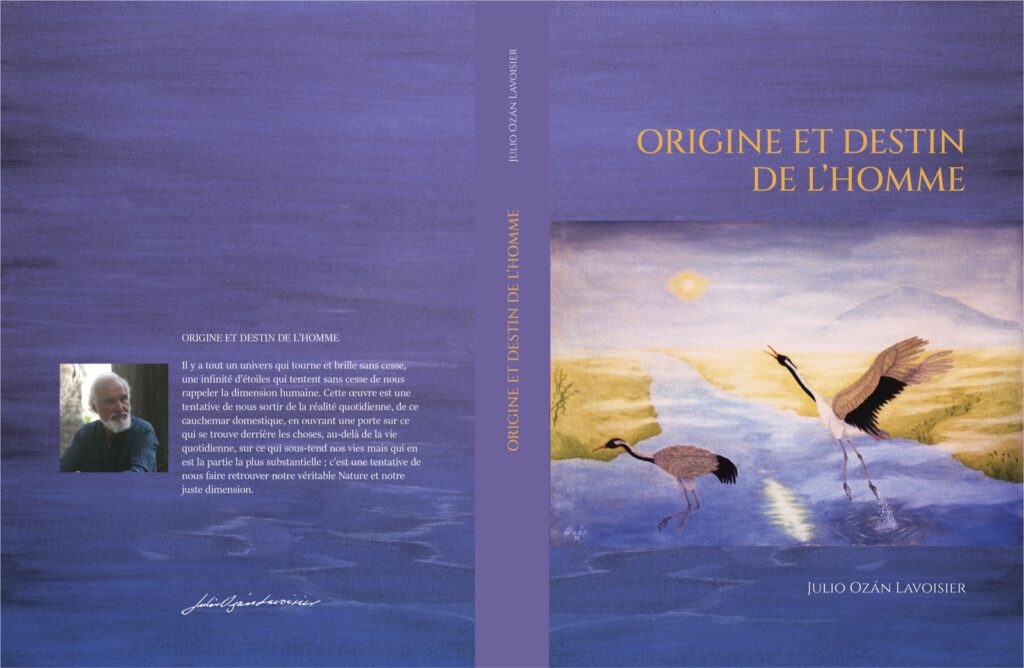
Ebook 2024
Couverture: peinture à l’uile de l’ uteur.
Avant de demander au lecteur de m’accompagner dans ce voyage, j’aimerais me présenter un peu, de sorte qu’il me paraît intéressant d’expliquer pourquoi j’écris. C’est la première chose qui me vient à l’esprit lorsqu’il s’agit de m’ouvrir au lecteur, de l’approcher et de lui rappeler qui nous sommes des membres de l’équipage d’un même bateau qui parcourt cette époque que nous vivons. Des coordonnées temporelles et spatiales infinies ont convergé pour qu’il en soit ainsi, une raison plus que suffisante pour lui parler en toute sincérité.
À une autre époque historique, j’aurais pris mon temps, j’aurais surement attendu mes dernières années pour terminer cet ouvrage, ce qui m’aurait permis d’y ajouter ce que la vieillesse peut enseigner; mais le temps presse.
J’aurais préféré continuer ma vie en paix, sans les habituelles préoccupations qui agitent les hommes, perdu dans les montagnes ou en mer, en train de contempler ou de découvrir de beaux endroits, ou me nourrissant de l’art et de la connaissance des plus sages. Mais pas un jour ne se passe sans que j’écoute frapper à la porte. Je ne sais pas qui m’appelle, si c’est un instinct ou une intuition, le destin ou une révélation, ou simplement une préoccupation ; ce qui est certain c’est que l’avenir de l’humanité est en jeu et quelque chose ou quelqu’un m’exhorte à agir.
Ce n’est pas que je prétende arrêter par mon action l’immense machinerie de l’industrialisation, qui rappelle, par diverses similitudes, celle imaginée par E. Zola dans La Bête Humaine, mais je ne peux pas la voir tourner ainsi, sans destin, sans rien faire1.
N’étant pas un intellectuel par nature, écrire me demande un effort double et le triple de temps, que, je le confesse, je regarde parfois avec nostalgie, en pensant aux nombreuses expériences de vie que j’ai laissées dans le sac des possibilités infinies de la vie. Ce n’est pas faute de mieux (en français dans le texte) que j’écris, cela je peux l’assurer au lecteur. À proprement parler n’importe quelle activité est mieux d’un point de vue personnel, que d’écrire de la philosophie à une époque où les valeurs sont sens dessus dessous ; c’est la façon la plus sûre de s’assurer pauvreté et dédain, si ce n’est la rancœur de ceux-là même que l’on veut aider. Ce sont d’autres raisons, qui transcendent ma personne, qui me poussent à écrire. Sauf, peut-être, le fait qu’il me soit intolérable d’observer le désordre esthétique et le chaos moral dans lesquels se développe notre culture.
Je souhaiterais par la même occasion, relater au lecteur des événements qui ont été à l’origine de la préoccupation qui n’a cessé de grandir en moi depuis lors, et qui sont l’une des raisons qui m’ont poussé à écrire.
Cela fait déjà plus d’un quart de siècle que j’ai eu la chance de réaliser un rêve : celui de visiter les îles du Pacifique Sud en voilier. Il est possible que ce soit là un rêve commun aux humains de notre culture. Peut-être parce que l’idée d’un bateau aux voiles déployées dans le grand océan est reliée à un sentiment de liberté ; tout comme les îles du pacifique sont reliées d’une certaine manière à l’idée de paradis.
Nous ne nous arrêterons pas sur ce point pour vérifier s’il existe objectivement un endroit appelé paradis, cette vérification serait puérile et étrangère au but auquel je prétends, mais nous ne pouvons nier qu’un tel endroit, en tant qu’idéal de perfection, ainsi que le désir de liberté, ont été présent dans l’esprit de l’homme depuis la nuit des temps, qu’il s’agit d’une réalité humaine et historique, car ce n’est pas resté dans un monde d’idées séparées de la réalité concrète, mais, comme toute réalité psychique, cet idéal et ce désir se manifestent, se concrétisent d’une façon ou d’une autre. En effet, l’être humain s’obstine à recréer consciemment ou non, l’idée de paradis. Les châteaux, parcs et jardins en sont, d’une certaine façon, des images, des expressions ou des imitations.
Il y a des périodes dans l’histoire où les esprits semblent plus élevés, car ils ont une plus grande facilité à imaginer, représenter et réaliser les délices de l’Elysée, et d’autres périodes, plus plates, durant lesquelles la réalité se fait plus brumeuse, les esprits manquent de cette élévation et se tournent vers une autre idée qui a aussi été une constante chez l’être humain : celle de l’enfer.
Au cours de ce voyage, j’ai eu la chance de trouver un paradis, non pas créé par l’homme, mais pas la nature elle-même, qu’elle a construit par un travail incessant durant des centaines de milliers d’années, avec un goût exquis des anneaux de coraux, qui, en se refermant, ont laissé en leur centre des sortes de lacs d’eaux turquoises, entourés de l’immense océan. Comme ce sont des îles très basses, avant de voir leurs palmiers, le navigateur peut percevoir de loin leur présence grâce aux nuages au-dessus d’une légère couleur turquoise qui reflètent les eaux des atolls.
Décrire la beauté de ce spectacle, suivi de l’apparition des palmiers, qui semblaient plantés dans l’eau, ainsi que l’expérience d’entrer dans ces lacs de coraux par l’une des minuscules ouvertures de l’anneau, serait une prétention inutile. Les eaux ici n’ont pas de couleurs, elles semblent bleues par leur magnitude, tout comme le ciel, mais elles sont simplement transparentes, ce grâce à quoi on peut voir des poissons de toutes les couleurs et formes inimaginables qui passent en caravanes de différentes espèces. On aperçoit sans difficulté au fond des tâches sombres, ce sont des coquillages marins dont la nacre iridescente contient parfois un trésor : des perles. Les natifs de ces îles étaient heureux, gentils et généreux.
À certaines époques, disais-je, l’homme aspire à la réalisation d’idéaux élevés, à d’autres époques, par ignorance, il se tourne dans la direction opposée. Dans ce cas, cependant, il ressent le besoin de justifier son action négative par des arguments positifs, comme par exemple, le fait que son penchant est tourné vers le bien, le progrès, la démocratie, etc. Mais lorsque la raison confond le beau avec le laid, le bien avec le mal, bref, le paradis avec l’enfer, c’est qu’il existe un grave déséquilibre mental, et lorsque les arguments employés par cette raison finissent par convaincre une société, nous nous retrouvons face à une folie collective. Il convient de noter que la condition du fou est d’ignorer sa folie. C’est-à-dire qu’il ne suffit pas à un individu ou à une société de se croire sains d’esprit pour l’être. J’entends par là que toute une société peut souffrir d’un sérieux déséquilibre mental et peut ne pas en être conscient.
Quelques semaines à peine après avoir quitté ce paradis d’êtres heureux plongeants pour la nacre dans des eaux turquoises, nous sommes arrivés sur une île déjà envahie par le progrès matériel. A Tahiti plus exactement. Le port abritait toute une flotte moderne. Ce n’était pas là des coquillages iridescents qui brillaient, mais des canons, des missiles, des radars, etc. sur les énormes navires. Cette flotte était là pour réaliser une expérience : une explosion nucléaire dans les atolls que je venais de visiter. Le remplacement de ces îles de rêve par une boule de feu, de cette merveilleuse faune marine par des monstres qui pouvaient rivaliser avec l’imagination de Bosch, … bref, je crois que le contraste entre paradis et enfer sera évident pour toute personne équilibrée.
J’ai tiré, de l’immense douleur et de l’indescriptible sentiment que m’a laissés cette expérience, une conclusion : l’homme (lorsqu’il n’est pas aliéné), est un être naturellement et spirituellement relié à son milieu, la planète Terre. C’est la première raison qui m’a poussée à écrire.
Ce n’est pas tout. L’être humain, comme l’aura remarqué le lecteur dans ses amitiés, ressent le besoin de partager son savoir ou son avis, et il le fait de façon si spontanée que cela lui parait « naturel ». Mais la question n’est pas si simple. Si l’on observe de plus près, nous verrons que nous sommes prisonniers d’une étrange compulsion à dire ce que nous pensons, même si nous savons invariablement que nous ne changerons rien en parlant de sujets politiques ou sociaux.
Lorsque nous exposons notre avis à des tiers, nous voulons étendre notre pensée, mais ce d’une curieuse manière. C’est plutôt comme si nous prétendions « semer » ou « inséminer » notre esprit dans l’espoir latent qu’il finisse par « germer » éventuellement chez notre prochain. Sans but précis, nous semons dans presque toutes les oreilles dès qu’elles nous semblent réceptives, comme si c’était une condition suffisante pour être fertile, même en sachant intimement que nous travaillons sur un terrain stérile. Nous sommes donc en proie à une sorte d’instinct qui nous pousse à nous projeter sur nos semblables, comme s’ils étaient une extension de nous-mêmes, comme s’ils faisaient partie de notre famille et nous avons besoin, comme avec cette dernière, de maintenir un certain contact. Mais cette connexion ne s’explique pas seulement de manière biologique, car notre nature corporelle ne nous oblige pas entièrement à la maintenir.
Nietzsche, solitaire invétéré, disait que lorsqu’Aristote soutenait que « l’homme est par nature un animal politique ou social », il avait oublié le philosophe, en faisant référence à lui, qui était totalement asociale. Mais Nietzsche lui-même n’a jamais cessé de penser et d’écrire pour les autres. Dans mon cas, j’ai vécu isolé la majeure partie de ma vie, car je considérais cela vital pour le bon développement de mon esprit, mais il n’a jamais été pour autant détaché de mes semblables même lorsqu’une montagne ou une mer me séparaient du premier être humain.
Je veux dire qu’il existe une autre façon d’être social que celle envisagée par Aristote, ceux qui, sans avoir de vie sociale, entretiennent des relations d’une certaine façon avec la société et y prennent part. Ainsi, tous les êtres humains, y compris « les quelques savants de ce monde » qui choisissent une « vie retirée » comme Fray Luis de León lui-même, écrivent ou maintiennent des relations sporadiques avec les personnes les plus proches ou épistolaires avec les plus lointaines, ou du moins, ils « prêchent » par l’exemple.
Et bien qu’il soit difficile pour Aristote d’accepter cette façon d’être social, il dit à juste titre : « C’est une propriété propre à l’homme, qui le distingue des autres animaux, que d’être l’unique à percevoir le bien et le mal, le juste et l’injuste et les autres qualités morales, et c’est la communauté et la participation dans ces affaires qui fait […] une cité-état » (Politique 1253 a). Étant donné que le bien et le mal, et les autres qualités morales sont des questions qui concernent particulièrement le philosophe, même s’il ne vit pas au sein de la communauté, il participe à la vie sociale de par son apport sur la question et de par d’autres connaissances, si décisives pour le bon développement de la communauté et de l’espèce. Nous voyons ici aussi, qu’il existe un lien qui transcende notre nature animale, qui nous relie de façon plus intime et puissante. De sorte que je crois que l’affirmation d’Aristote serait à reformuler ainsi : l’homme, qu’il soit social ou non, est un être naturellement et spirituellement relié à ses semblables. C’est la seconde raison pour laquelle j’écris.
Après de nombreuses années de recherche et de nouvelles expériences qui ont élargies cette vision, j’ai trouvé une troisième raison qui me pousse à écrire. Celle-ci implique les deux autres, mais pour être comprise, il faut suivre le chemin que je propose ci-dessous. Le lecteur qui m’accompagnera se rendra compte qu’une fois que l’on en a pris conscience, on sent le devoir de contribuer à l’Ordre.
Ranch Kuan (La contemplation), au pied des Andes, Mendoza, Argentina, 2000. J. O. L.
SOMMAIRE
Prologue
Préface
1ère Partie L’ORIGINE
1. L’origine de l’homo sapiens
2. La conformation de la psyché
3. Origine des facultés unitives
4. La psyché et son évolution
5. Le complexe originel
6. Le conflit originel
7. Liberté et bonheur
2ème Partie : LES MOYENS
1. LA CONNAISSANCE
2. Théorie et connaissance de la psyché
3. Le plan naturel de l’entendement
4. Connaissance unitive
5. Connaissance unitive et accumulative
6. Intuition du changeant et du permanent
7. La vision des choses en soi
3ème Partie : LE DESTIN
I 1. LA CONSCIENCE UNIVERSELLE
2. Conscience individuelle et universelle
3. Aliénation de la Conscience Cosmique
4. Dualisme et monisme
II 1. ESPRIT ET MATIÈRE
2. Temps et espace
3. Origine de la matière
4. L’expérience du Transcendant
III 1. COSMOLOGIE
2. Instinct et manifestations premières
3. Cosmologie dogmatique
4. Deux forces dans le cycle de la Vie
5. Expansion et unification
IV 1. LA VIE ICI ET LA-BAS
2. La vie dans sa totalité
V EVOLUTION
1. L’évolution du point de vue des scientifiques
2. L’évolution spirituelle
3. Stades de l’homme
VI LA SITUATION ACTUELLE
1. Icare ou le futur des sciences
2. Evolution spirituelle et technologie
3. Globalisation
4. Deep ecology
5. Surpopulation
6. Sur adaptation
7. Perception esthétique et morale
VII CONCLUSION
1. Pourquoi l’homme reste dans l’ignorance
2. Intégration totale
3. Instinct de perfection ou de destin
4. En route vers notre destin
LES RACINES DE LA MORALE
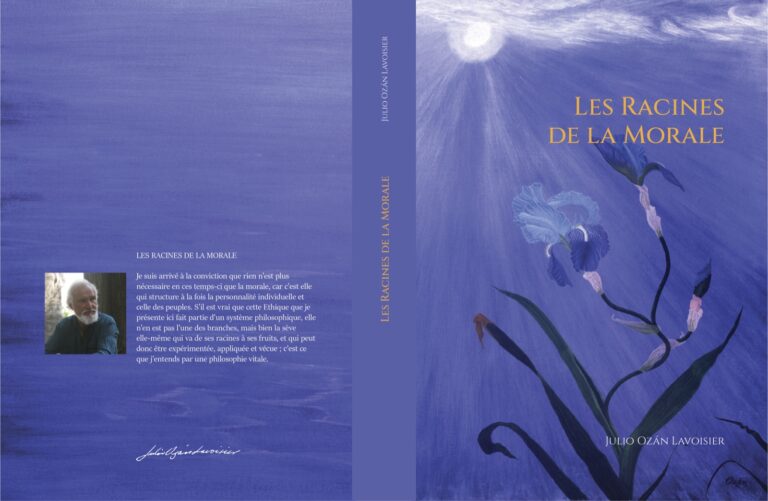
Ebook 2024
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE
Brève histoire de la morale
Introduction
Éthique y Psychosophie
Postulats méthodologiques
L’ETHIQUE EN PERSE
L’ETHIQUE EN CHINE
Le taoïsme
Le confucianisme
Confucius
Le Yi Jing
L’ETHIQUE EN INDE
L’ETHIQUE GRECQUE
Socrates
Platon
Aristote
L’équilibre et les autres vertus grecques
De la conscience morale grecque
La loi et la politique
La vision cyclique de l’histoire
Périclès, exemple d’illustre dirigeant
Epicure
L’ETHIQUE ROMAINE
Sénèque, de la clémence
Marc Aurèle
Plotin
DEUXIÈME PARTIE
La morale dans le christianisme
La Bible
Genèse de la morale chrétienne
Jésus et les pharisiens
La doctrine paulinienne
Politique ecclésiastique
Quelques patriarches de l’Eglise
Morale judéo-chrétienne
Du bonheur
De l’âme individuelle
TROISIEME PARTIE
L’éthique dans la Renaissance, le Siècle des Lumières et le Romantisme
La Renaissance
Quelques exemples de morale renaissante
A propos de l’individualisme
Les vertus du mécénat
Le Siècle des Lumières
Voltaire
Voltaire et la Révolution
Kant
Qu’est-ce que le siècle des Lumières ?
La morale de Kant
La liberté
L’immortalité
Le Dieu de Kant
L’homme comme cause finale
Récapitulation
Fichte
Des intuitions transcendantales
Sur la bonté de l’homme et son éducation :
Rousseau
Schiller
Une nouvelle éthique en Amérique
La morale héritée remise en question
Nietzsche et la morale chrétienne
L’Antichrist
Affirmations et erreurs de Nietzsche
Nietzsche, Schopenhauer et ascétisme
Nietzsche, Schopenhauer et la volonté de pouvoir
QUATRIEME PARTIE
Morale et société
De l’esprit noble et du vulgaire
La morale chrétienne de nos jours
Morale marxiste
La proposition hellénique
Morale actuelle ou de masse
Education morale
Conscience sociale
Trois positions face à l’exemple
Imitation et démocratie
Idéologies de la violence
L’état de besoin
La surpopulation est un excès
Processus d’extériorisation, aliénation et consommation
Politique morale
L’illustre dirigeant
La République et la démocratie
De l’inversion de la culture
Méritocratie
Essence et existence
Récapitulation
CINQUIEME PARTIE
Ma proposition : L’ascension de l’esprit vers la conscience morale
La nécessité de la morale
Sur l’évolution et la stagnation morale
Sur le bien et le mal
Le concept d’humain
Les deux consciences de l’homme
De l’Unité originelle
L’Un et l’Unité
La fonction transcendante de la morale
La conscience morale est unitive
Perspective unitive pour la morale
Des vices et des vertus
Sympathie et antipathie
Raison naissante
Pourquoi personne n’est prophète sur sa terre
Spontanéité
Sur la relation amoureuse
Sur l’amour
Du plaisir et du bonheur
Liberté et Bonheur
Idéalisme moral
Dieu comme Conscience
Synthèse de mon éthique
Brève cosmologie morale
Le Créatif
EPILOGUE
Une vision de ma vie d’en haut et de loin
Maximes et paradoxes
L´Évolution de l'Esprit
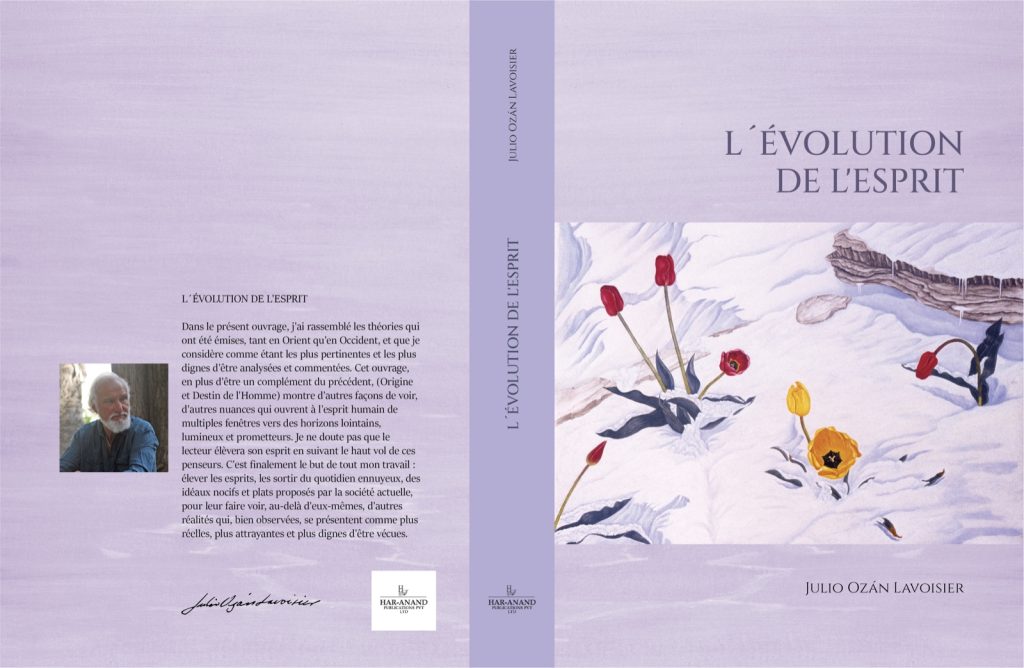
Dans le présent ouvrage, j’ai rassemblé les théories qui ont été émises, tant en Orient qu’en Occident, et que je considère comme étant les plus pertinentes et les plus dignes d’être analysées et commentées. Cet ouvrage, en plus d’être un complément du précédent, (Origine et Destin de l’Homme) montre d’autres façons de voir, d’autres nuances qui ouvrent à l’esprit humain de multiples fenêtres vers des horizons lointains, lumineux et prometteurs. Je ne doute pas que le lecteur élèvera son esprit en suivant le haut vol de ces penseurs. C’est finalement le but de tout mon travail : élever les esprits, les sortir du quotidien ennuyeux, des idéaux nocifs et plats proposés par la société actuelle, pour leur faire voir, au-delà d’eux-mêmes, d’autres réalités qui, bien observées, se présentent comme plus réelles, plus attrayantes et plus dignes d’être vécues.
SOMMAIRE
Préface
Préface de la version anglaise
1ère Partie : EVOLUTION BIOLOGIQUE ET SPIRITUELLE :
I 1) Darwin
2) Habilis u sapiens ?
2ème Partie : TROIS THEORIES OCCIDENTALES
I) 1 Hegel
2 La religion d’Hegel
3 Hegel et la psychologie
4 Hegel et la psychosophie
II) 1 Henri Bergson
2 Intuition
3 Mémoire
4 La liberté et l’Absolue
5 Elan vital et évolution
6 Morale et religion
7 Bergson et la psychosophie
III) 1 Teilhard de Chardin
2 La religion de Teilhard
3 Commentaire
3ème Partie : DEUX DOCTRINES ORIENTALES
I) Introduction
II) 1 Bouddhisme
2 Le bouddhisme Mahayana
3 Les écoles mahayanas
4 Nagarjuna
5 Yogacara
6 Ashvaghosha
7 Le Shurangama Sutra
8 Le Shurangama et la psychosophie
9 Le Vimalakirti Nirdesa Sutra
10 Le Lankavatara Sutra
11 La méthode Mahayana
12 Bouddhisme Chan ou Zen
13 Le Maître Huang Po
14 Unité du bouddhisme
15 Pragmatisme du Bouddha
16 Atman et karma
17 Bouddhisme et la psychosophie
18 Souffrance et joie
III) 1 Sri Aurobindo
2 La conception cosmique terrestre
3 La conception supraterrestre
4 La conception supra-cosmique
5 La connaissance directe
6 La psychologie transcendantale d’Aurobindo
7 L’évolution spirituelle
8 Quelques comparaisons
4ème Partie : COMMENTAIRE CONCLUANT
2 Noosphère et hominisation
3 L’expérience transcendantale
4 La Réalité à la lumière de la théorie et pratique des perspectives
5 L’évolution a-t ’elle un destin ?
L'Esprit dans L'Histoire
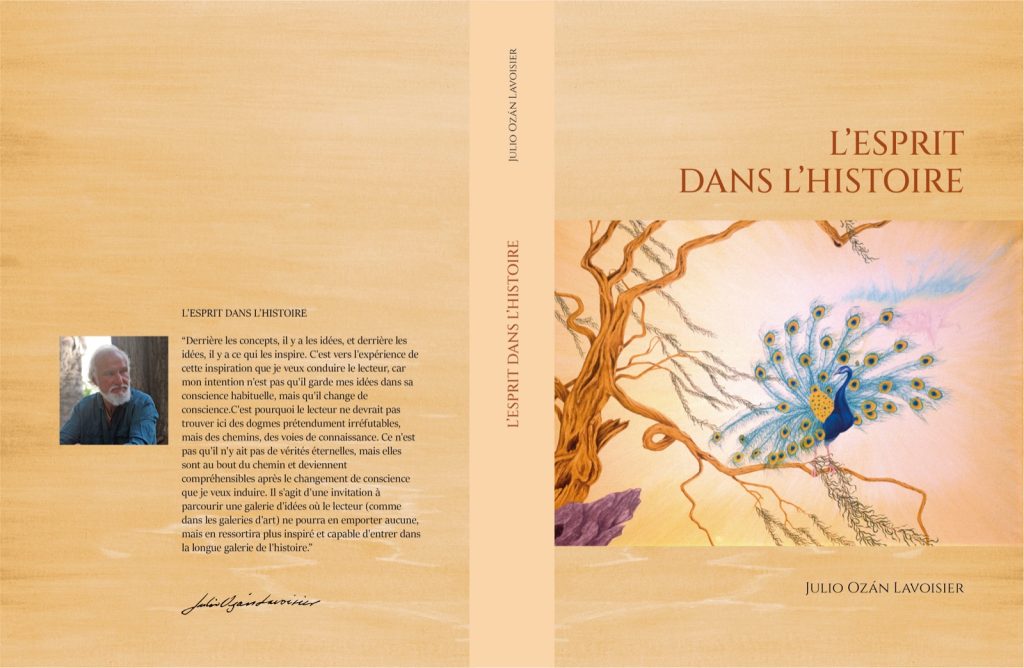
Derrière les concepts, il y a les idées, et derrière les idées, il y a ce qui les inspire. C’est vers l’expérience de cette inspiration que je veux conduire le lecteur, car mon intention n’est pas qu’il garde mes idées dans sa conscience habituelle, mais qu’il change de conscience.C’est pourquoi le lecteur ne devrait pas trouver ici des dogmes prétendument irréfutables, mais des chemins, des voies de connaissance. Ce n’est pas qu’il n’y ait pas de vérités éternelles, mais elles sont au bout du chemin et deviennent compréhensibles après le changement de conscience que je veux induire. Il s’agit d’une invitation à parcourir une galerie d’idées où le lecteur (comme dans les galeries d’art) ne pourra en emporter aucune, mais en ressortira plus inspiré et capable d’entrer dans la longue galerie de l’histoire.
SOMMAIRE
Préface
Faits et idées
Idéalisme universel
Vérité et philosophie
Les principes premiers
La situation de l’homme
La psyché dans l’histoire
Le philosophe dans l’histoire
Psycosophie de l’histoire
La Conscience universelle
L’Unité et ses dérivés
La perspective dans les consciences
La perspective dans l’histoire
Le contingent dans l’histoire
Historicisme
Le progrès est inconstant
Héritage, culture et créativité
L’homme supérieur et inférieur
Esprit ascendant et descendant
Génie et sagesse
Déplacements de l’esprit dans l’Histoire
Les courbes dans l’histoire
Époques d’apogée
Époques de périgée
Causes d’apogées et de périgées
Époques exemplaires
Époque cruciale
La dialectique dans l’Histoire
La dialectique des extrêmes
La raison naissante
Connaissances subjective, objective et unitive dans l’histoire
Le juste milieu
États et stades de la conscience
Plans de l’entendement et niveaux de conscience
Les générations
Processus générationnel
Les modes et les générations
La langue dans l’histoire
La biologie dans l’histoire
L’éducation dans l’histoire
La religion dans l’histoire
L’homme, un être universel
Homo habilis et Homo sapiens ou unitif
Le destin de l’histoire : bonheur et liberté
Ce qui touche l’homme fait bouger l’histoire
Les Racines de L'Art
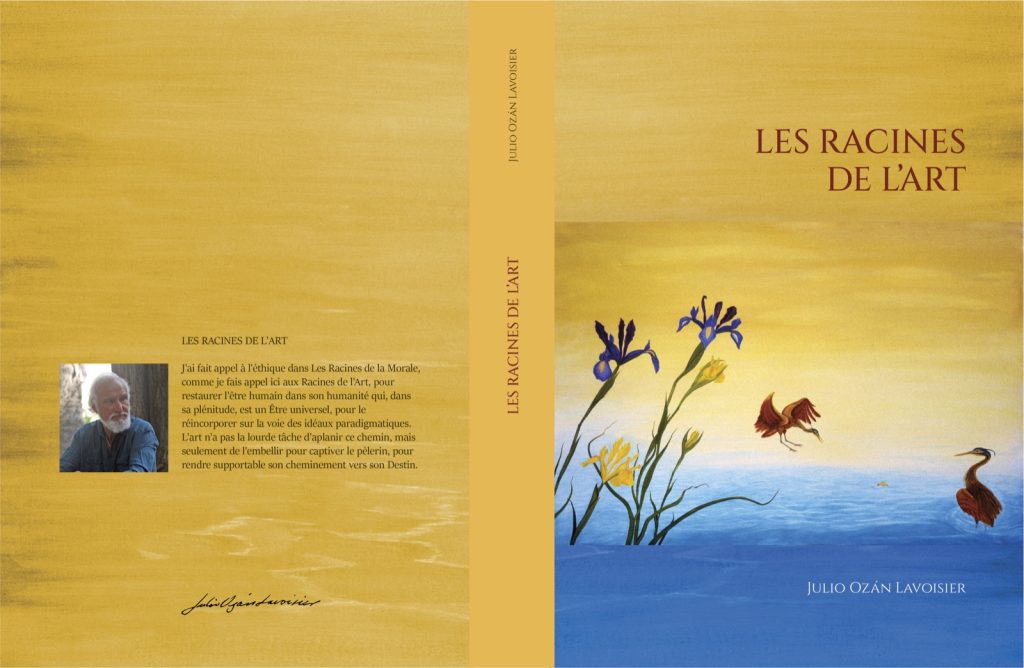
J’ai fait appel à l’éthique dans Les Racines de la Morale, comme je fais appel ici aux Racines de l’Art, pour restaurer l’être humain dans son humanité qui, dans sa plénitude, est un Être universel, pour le réincorporer sur la voie des idéaux paradigmatiques. L’art n’a pas la lourde tâche d’aplanir ce chemin, mais seulement de l’embellir pour captiver le pèlerin, pour rendre supportable son cheminement vers son Destin.
SOMMAIRE
LES BASES Dossier A
Introduction
De l’entendement et ses mécanismes
La voie esthétique (de la Psycosophie)
Mémoires accumulative et unitive (de la Psycosophie)
Esthétique et conscience unitive
Conscience esthétique et philosophie
Esprit et matière
De l’Esprit dans la Nature
Morale et esthétique
La magie de l’art
Les racines de l’inspiration
De l’inspiration
L’inspiration pour l’artiste
La vie en tant que rêve
La mer et le noumène esthétique
La danse
De l’Amour
Types de beauté
Le nu
De la rhétorique
Le génie
Principes de l’art
La fonction sociale de l’art
Des Racines et de leurs Manifestations
Esthétique transcendantale
Le Transcendant et le Temps
CINQ PHILOSOPHES A PROPOS DE L’ART
Platon et les artistes
Plotin
Schelling
Hegel
A propos des idéalistes allemands
Schopenhauer
ART ET RELIGION
Religion et Nature
La mythologie et les arts
Mythes et littératures
Les formes et les grecs
Le sens tragique et héroïque de la vie
Des faits héroïques à l’épopée
L’EPOPEE ET LES INVOCATIONS
Homère
Hésiode
Virgile
Proclus
Dante
La fin des invocations
L’épopée romantique
L’épopée hindoue
La Bhagavad Gita
Le Mahabharata
Le Râmâyana
La fin de l’épopée
LA TRAGEDIE Dossier B
A propos de L’Origine de la Tragédie
La Vision Dionysiaque du Monde
De l’origine de la morale et de la décadence de la tragédie
Les présocratiques et la tragédie
Ma vision de la tragédie grecque
Eschyle
Sophocle
Euripide
Shakespeare
Corneille et Racine
LA RENAISSANCE
L’esprit de la Renaissance
Individualisation et équilibre
Humanisme
Renaissance de l’homme, de la Nature et des dieux
La Cité-Etat embellie
L’importance du mécénat
La religion dans la Renaissance
Bonheur, ascétisme et beauté
Le déclin de la Renaissance
L’esprit dans le Baroque
Le Romantisme
L’esprit romantique
Schiller
La Nature dans le Romantisme
Crise et déclin du Romantisme
Le chant du cygne
L’Esprit dans la Nature en Amérique
Synthèse
L’ART en CHINE et au JAPON
ART CONTEMPORAIN en Occident
L’existentialisme
Esthétique actuelle
Individualisme ou des-universalisation de l’art
De la nouveauté dans l’art
Esthétique et goût
Le triomphe du fonctionnel sur l’esthétique
La déshumanisation de l’art
Borges et l’éternité
Synthèse
Epilogue, deux poètes
Hölderlin
Rubén Darío
L’essentiel de la question



